PARTIE 2 : L’ANALYSE STILL IN ROCK DU PODCAST (click here)
*********
PARTIE 1 : NOTRE INTERVIEW
(retranscription de notre conversation téléphonique)
Par Thibault S.
Thibault : Bonjour Bret, merci de prendre le temps de faire cette interview. Comment vas-tu ?
BEE : Salut Thibault, très bien merci. Et toi, comment vas-tu ?
Thibault : Très bien également. On commence ?
BEE : Je suis tout ouïe.
Thibault : OK. Je voulais, pour commencer, savoir si tu penses que le rock’n’roll est quelque chose de sérieux, et s’il doit l’être de toute façon ? Certains, je pense notamment à Lester Bangs, ont émis l’hypothèse que c’était juste une blague, une forme d’art qui n’est pas sérieuse par nature. Qu’en dis-tu ?
Lui : Je crois que la vérité est à mi-chemin. Ce qui est important, c’est la notion de plaisir. Ce qui m’a plus dans le rock, c’était les émotions qu’il me donnait. Ce n’était pas cérébral ou intellectuel. Même lorsque tu as affaire à de très bons paroliers, comme Elvis Costello ou Bruce Springsteen, c’est toujours l’émotion qui m’interpelle. C’est pour cette raison que j’aime certaines choses que les snobs n’aiment pas. J’aime les chansons de pop qui sont trash et un peu idiotes. Les paroles ne comptent pas vraiment pour moi dans le rock.
Lorsque je dis que j’aime que le rock soit crétin, ce dont j’ai parlé aujourd’hui dans mon podcast avec Kim Gordon, ça ne veut pas dire que c’est une blague, mais simplement que la musique est émotionnelle avant tout. Tout art est émotionnel. Ça implique également de considérer les notions de plaisir et de technicité. On admire souvent la technicité, j’admire un bon guitariste ou un bon batteur, mais dans le rock, tu ne veux pas que l’on voit que tu te donnes trop de mal.
Et puis, de toute façon, c’est assez bizarre de parler de ça parce que le rock est mort. Où sont les groupes de rock ? Tu dois écouter de la country pour trouver des gens qui écrivent de bonnes chansons de pop ou de rock aujourd’hui, mais ça, c’est une autre histoire.
Thibault : Le “rock est mort”… hm… assurément quelque chose que l’on n’entend pas souvent… Mais alors, que dire de l’idée de rock’n’roll “post-Empire”, ce rock créé en 1977 avec la scène punk qui vénérait l’idée d’une musique underground ? Tu as évoqué les Eagles plusieurs fois dans ton podcast et certains de tes invités s’y sont montrés réticents, à l’image de Stephen Malkmus. En règle générale, les gens qui aiment le punk ont tendance à ne pas aimer les Eagles et tout ce rock “Empire”. Qu’en est-il pour toi ?
BEE : J’aime de nombreux styles de musique, j’aime la country, le hip-hop, la soul, le punk, la new-wave… Je ne suis vraiment pas un snob. J’aime vraiment beaucoup de musique, il ne s’agit pas de choisir entre un style ou un autre. Je vois bien la façon dont le punk est né en réaction à ces musiciens “Empire” des années ’70, contre l’idée de passer des années entières et dépenser des millions afin d’atteindre le son parfait, comme le faisaient Pink Floyd ou les Eagles ou Led Zeppelin.
L’esthétique punk était une révolte contre ça, une façon de dire que ce tout ce qui compte dans le rock c’est trois cordes de guitare et une attitude. Les punks étaient opposés à ces riches hippies qui restaient des années en studio. Ils étaient opposés au fait que le rock ait été coopté par les grandes entreprises.
Le problème avec la musique “post-Empire” tient dans la démocratisation de la musique elle-même, cette idée que tout le monde puisse faire de la musique, que tu n’aies pas besoin de savoir comment jouer un instrument ou écrire des titres pour avoir des hits. C’est une idée vraiment inhabituelle. Je ne sais pas si quelque chose de vraiment bon est ressorti de ce mouvement, mais il est certain qu’il influence une large partie de la scène actuelle. Les ventes de solistes ont chuté depuis 5 ou 10 ans, ce que je trouve très intéressant. L’envie de devenir guitariste est en train de s’évaporer. Je ne sais pas si c’est ou non une bonne chose, mais c’est un fait.
Thibault : Ah ça, je ne vois pas pourquoi ça serait une bonne chose, mais c’est juste mon avis.
BEE : Tu penses que c’est une mauvaise chose ?
Thibault : Assurément ! Quelques rares artistes comme Kurt Vile perpétuent cette volonté d’être soliste, ce pour quoi j’aime tant son nouvel album, mais force est de constater qu’il y a tellement peu d’albums de rock qui se focalisent sur le son des instruments…
BEE : J’aime également Kurt Vile, mais j’aurai voulu qu’il écrive de meilleurs titres. Il jouait dans un groupe qui s’appelle The War on Drugs, un bon groupe américain, au moins en ce qui concerne leur dernier album. Ce groupe sait comment écrire de bons morceaux. Kurt Vile a un super son et j’aime son attitude, mais je ne suis pas sûr qu’il ait trouvé comment écrire de bons titres.
Enfin… quand je m’entends dire ça, je me dis que je suis trop corporate, “oh, tu dois écrire de bons morceaux”. Mais après tout, c’est ce que j’aime, de bons morceaux, même si j’apprécie également écouter ses jams de 8 minutes…
Thibault : Ce qui compte, à mon sens, c’est l’expérience d’ensemble, la présence de bons morceaux, mais aussi celle de longs jams et de solos de guitare… Cela me fait penser aux propos qu’a tenu Ariel Pink dans votre conversation. Il défendait l’idée que nous devrions peut-être oublier les grands groupes des 50 dernières années de sorte que les jeunes artistes soient en capacité de créer quelque chose de véritablement nouveau. C’était, je dois dire, la première fois que j’entendais une telle proposition. Qu’en penses-tu ? La même pourrait s’appliquer aux écrivains, les plus jeunes devraient alors éviter de lire les grands auteurs afin de créer quelque chose de personnel…
BEE : Je pense que c’est ce qui est en train de se passer et je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un ne veuille ne pas écouter les vieux groupes de musique, ou lire de vieux livres, ou regarder des vieux films…
Je crois que les “génération du millénaire” et “génération Z” sont confrontées au trop-plein d’informations. Je me souviens avoir un jour demandé à quelqu’un de cette tranche d’âge, “comment ça, tu n’as pas vu ce film?”, ou bien, “comment ça, tu n’as pas écouté cet album des Rolling Stones?”, ou encore, “que veux-tu dire quand tu dis que tu n’as pas lu Raymond Carver ?”. La réponse était toujours : “je n’étais pas né à l’époque, désolé”. Je n’étais pas né que le premier album de Bob Dylan est sorti, mais je m’y suis quand même intéressé. Je n’étais pas né quand la plupart de mes livres préférés ont été édités, mais je les ai quand même lus. Alors de prime abord, je dois dire que cette réponse m’énervait, je la trouvais ridicule.
Et puis, je me suis rendu compte que c’était une sorte d’appel à l’aide. C’était une façon de dire, “je suis noyé dans le trop-plein d’informations”. Comment se tourner vers le passé dans ce cas là ? Comment peut-on attendre des gens qu’ils s’intéressent à 1975 lorsqu’il y a tant de choses à ingurgiter en 2015 ? Je suis donc devenu compatissant avec ces générations. Il est plus difficile que jamais de se tourner vers le passé.
Mais pour revenir plus directement à ta question, tout découle de quelque chose d’autre. Je ne crois pas qu’il soit possible de tracer une ligne, ne rien écouter et créer quelque chose de nouveau de la sorte. Tout influe sur tout, depuis des milliers d’années. Je comprends ce qu’Ariel a voulu dire, mais je ne crois pas que ce soit réaliste.
Thibault : Je suis tout à fait d’accord avec cette idée du trop-plein d’informations, je le ressens quotidiennement. Je me demandais par ailleurs si tu crois en l’objectivité dans l’art, au même titre qu’Oscar Wilde ? Cela revient en un sens à admettre que les jeunes artistes puissent évaluer la qualité de leurs créations sans se comparer à une autre décennie, ou un autre artiste, en somme, sans toute cette masse d’informations. A chaque fois que j’évoque ce concept d’objectivité, la réponse que l’on me donne est : “bien entendu qu’il n’y a pas d’objectivité dans l’art, rien n’est objectivement beau ou objectivement laid“. Je crois, à l’inverse, que certains aspects d’universalité confèrent une beauté à certaines œuvres. Qu’en dis-tu ?
BEE : Tout est subjectif ; bien entendu. Il n’y a pas d’art qui soit objectivement bon, et Dieu merci. J’aime lorsque les gens expriment des opinions contraires au sujet de quelque chose qu’il faut soit-disant avoir lu ou regarder parce que c’est supposément bon pour toi. Je trouve ça vraiment sain, j’aime cette idée qu’il n’y ait pas d’objectivité. Je crois que la “génération du millénaire” veut croire que cette notion existe, que tout est bon, ou que tout est mauvais si ça ne correspond pas à ses valeurs. C’est un problème majeur de notre société contemporaine, de notre “société du like” où, parce qu’une œuvre d’art exprime un message, elle doit automatiquement être considérée comme intéressante, en dépit du fait qu’elle puisse être merdique. Et cette idée gagne du terrain, ce qui me dérange bien entendu. Mais pour faire simple, je pense que tout est subjectif, et j’en suis très heureux.
Maintenant, je dis ça en tant qu’écrivain. Je vais recevoir un écrivain pour le podcast de demain et on va justement parler de ça. Nous écrivons depuis de nombreuses années et je crois que l’on peut effectivement prendre un livre et dire : “cette écriture est mauvaise”. En un sens, je ne sais pas si je me contredis, mais je pense que je peux à peu près dire si un livre est bon ou pas, de façon objective. Je peux dire, “l’écriture est pauvre, le rythme s’essouffle, pourquoi est-on page 4 et ce n’est toujours pas intéressant ?”. Dans le même temps, ma lecture du livre est subjective, même si je sais qu’il est objectivement mauvais.
Thibault : Je voulais justement m’entretenir avec toi de cette “société du like” dont tu parlais à l’instant, où tout le monde veut être aimé, ou les “J’aime” Facebook sont partout. Tu as de nombreuses fois émis l’hypothèse que quelqu’un qui exprime une opinion est souvent considéré comme un élitiste. Je ne pourrai être plus d’accord, mais je me demandais toutefois si tu penses-tu que ça s’applique aussi vis-à-vis de quelqu’un qui eprime une opinion positive ? Ou peut-être est-ce le seul fait d’exprimer une opinion qui est devenu interdit en un sens… ?
BEE : Voici quel est le problème. Nous sommes dans une société gouvernée par les grandes entreprises. Nous vivons sous leur emprise, que ça nous plaise ou non, nous sommes poussés à nous mettre en scène sur les réseaux sociaux, constamment, que ce soit via Instagram, Twitter, Facebook ou je ne sais quoi d’autre. Nous nous mettons constamment sous le feu des projecteurs, nous vendons une version de nous-même. Tout le monde le fait. Et dans cette culture d’entreprise, nous sommes poussés à rester positifs, justement parce que nous vendons quelque chose. Tu dois être positif, tu dois être heureux, tu dois tout aimer. Qui va acheter quelque chose à un troll grincheux et colérique qui pense que tout est pourri et que la société est un mensonge ? Bon, peut-être moi…
Les gens n’aiment pas la négativité parce qu’elle contrevient à ce qu’ils essaient de faire. C’est la raison par laquelle si tu dis quelque chose de négatif ou d’anticonformiste, que Dieu te pardonne, tu es immédiatement attaqué. C’est très inquiétant, cette idée que nous devons tous marcher main dans la main avec les grandes entreprises, parce que l’on a besoin d’elles pour nous vendre. Appuyer sur le bouton “J’aime” est précisément ce que tu fais dans cette culture de l’entreprise, tu n’appuies pas sur le bouton “Je n’aime pas”. La masse attaque les personnes qui ont des avis minoritaires, alors que ce ne sont que des avis ! Voilà la réalité, la culture de l’entreprise t’empêche tout simplement d’exprimer une opinion négative.
Thibault : Que penser alors du succès de comédiens comme Louis CK ? Il exprime des opinions négatives, et pourtant, les gens semblent l’apprécier…
BEE : Hmm, je ne pense pas que Louis CK ait des opinions négatives. Je crois qu’il a trouvé un terrain d’entente avec cette culture de l’entreprise. Lorsque je regarde ses spectacles, c’est une chose, mais ses
stand-ups en sont une autre. Ce ne sont pas les comédies de quelqu’un de révolté, il n’y est pas très incisif. Il y agit comme un père de famille, il y a toujours une sorte de qualité sentimentale. Même lorsqu’il a fait son sketch sur le pédophile au
Saturday Night Live, ce qui était le plus “choquant” que je l’ai vu dire, il était toujours empreint de cette positivité qui le caractérise, ce qui a probablement eu pour effet de renforcer l’effet recherché.
A vrai dire, il y a très peu de personnes du milieu qui ne se soumettent pas à cette culture de l’entreprise, même si je crois que l’on est actuellement en train de vivre une période de transition où les artistes vont commencer à être eux-mêmes, leur propre contradicteur.
Thibault : Tu penses donc que les artistes se sont éloignés de leurs propres valeurs ?
BEE : En effet. Ça a commencé à mon sens lorsque les médias sociaux sont apparus, en particulier Facebook. C’est le point de départ de cette exposition de chacun. La critique a alors commencé à être élitiste, parce qu’elle ne correspond pas à la façon dont les gens se présentent aux autres.
Thibault : Faisant moi même partie de la “génération du millénaire”, je ne peux qu’acquiescer. Je voudrai également évoquer avec toi ce qu’a dit Gerard Way dans le podcast. Il a expliqué être à la recherche d’une certaine théâtralité dans ses performances sur scène. C’est, à mon sens, également ce que visait David Bowie. Je me demande si c’est une bonne chose dans la mesure où ces artistes créent une fausse identité. Comme tu l’as dit dans ta conversation avec Judd Nelson, la sincérité d’un artiste est la chose la plus importante, et il y a pour moi une claire contradiction entre cette volonté de créer un personnage et la possibilité d’être sincère…
BEE : Tout dépend de ce qu’un artiste aime et de combien de temps il peut maintenir son identité. Gerard Way a en effet créé un personnage pour Chemical Romance, et dans une moindre mesure, il le fait aussi pour sa carrière solo. Nicki Minaj faisait de même, je me souviens du temps où elle avait toutes ses identités… Elle a depuis changé d’approche. Je me demande si c’est quelque chose qui est influencé par l’âge. Et puis, ça dépend aussi de la personnalité de chacun, j’imagine. Certaines personnes sont naturellement sincères tandis que d’autres jouent sur différents tableaux…
Mais le public demande une certaine sorte de réalité aujourd’hui. Ou du moins, que ce soit la réalité ou pas, il demande un certain type d’authenticité. Je ne sais pas dans quelle mesure cela influence les groupes du moment. J’ai récemment regardé les MTV Video Music Awards, plus ou moins tous les artistes y étaient sincères. Miley est vraiment Miley Cyrus, elle ne joue pas un personnage, Taylor Swift est elle même et ça vaut également pour Kanye.
Je crois que l’on se dirige vers une époque où les artistes seront de plus en plus à la recherche d’authenticité. Cela ne signifie pas que la théâtralité soit effacée de l’équation, par exemple, les concerts de rock sont de plus en plus théâtraux, c’est une exigence pour attirer les foules. L’idée d’avoir juste un groupe sur scène sans effet visuel n’est plus viable. Ça n’arrive plus à Coachella, ça n’arrive plus dans aucun festival. Tout doit être un show. Malgré tout, le public attend une certaine authenticité de la part du leader, du chanteur, des performeurs, que tu sois The Weeknd ou Sia. J’essaie de penser à un performeur pop qui se cache derrière une identité… Justin Bieber n’en fait pas partie…
Le public recherche également un certain type de sentimentalité, un narratif victimaire. On le voit très bien chez de jeunes artistes comme Sam Smith ou Ed Sheeran. Il y a un manque de colère et de luxure, ce sont des choses authentiques qui semblent étrangères à la nouvelle génération de musiciens.
Thibault : Sans doute oui ! Peut-être ce manque de colère vient-il du fait qu’une colère véritable n’est pas bankable. Peut-être vient-il du fait que l’on veut une représentation idyllique de nos artistes. Tout doit être parfait, rapide et parfait. A ce sujet, tu l’as d’ailleurs mentionné plusieurs fois dans le podcast, les artistes utilisent de plus en plus le format “single“. Un album complet est devenu héroïque en un sens. Il me semble que de moins de moins de personnes se soucient de l’album en tant qu’expérience globale, toute l’attention est portée sur les “singles“, sur les clips YouTube, sur l’écoute de Soundcloud dans laquelle le contexte de la musique n’est jamais donné.
J’y vois un lien avec ce que Hermann Hesse décrivait comme étant la “société de la vitesse”, l’idée que, parce que nous avons tellement d’informations à ingurgiter et que nous devons nous exposer constamment, il y a une accélération de la vitesse à laquelle nous devons consommer de l’art, et, par la même, détruire nos vies privées. L’impact sur l’art est énorme. Que fais-tu, en tant qu’artiste, pour lutter contre cette “société de la vitesse”, pour ne pas céder à la pression de publier un livre chaque année, pour ne pas produire un nouveau film chaque année…? Ressens-tu cette pression, ressens-tu le fait que les gens te demandent constamment plus ?
BEE : Bien entendu que je ressens cela ! Je le ressens tous les jours ! Je ressens la pression de constamment mettre des photos sur Instagram. Je ressens la pression de tweeter tout le temps. Je ressens la pression de mettre constamment mon profil Facebook à jour. Je ne le fais pas… mais je ressens cette pression. La pression de s’exposer et de faire entendre sa voix est partout. Ça me fatigue. Je ne fonctionne pas de cette façon et je ne peux m’y soumettre. Mais je ressens constamment la pression de publier un autre livre. Seulement, c’est un processus qui peut prendre beaucoup de temps, ce n’est donc pas une possibilité.
J’ai beaucoup à faire dans ma vie professionnelle. Par exemple, cette semaine, je prépare mon podcast, je mets à jour un scénario que j’ai écrit, je travaille sur un article, j’écris une web série pour une nouvelle chaine Internet et je travaille également avec un artiste à Los Angeles sur une exposition qui sera présentée en février.
En réalité, grâce à tous les moyens de communication à ma disposition, qui me permettent de communiquer avec des artistes, des musiciens et des cinéastes, je suis beaucoup plus heureux que lorsque j’étais un simple romancier à New York. Avant l’apparition de ces technologies, j’étais seul dans mon appartement à écrire mes romans. L’époque actuelle est bien plus excitante. C’est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui attendent mon prochain roman, mais je ne peux pas me forcer à l’écrire. Et puis, je ne sais pas trop où la forme littéraire du roman va de toute façon. J’ai mes doutes sur le roman.
Mais oui, je me sens constamment sous la pression de m’exprimer, d’être présent. Je ne sais à vrai dire pas comment certaines personnes pourraient ne pas la ressentir, et j’admire ceux qui s’extraient des réseaux sociaux. J’admire les gens qui ne sont pas sur Facebook ou sur Twitter, ceux qui ne sont pas en train d’Instagramer tout le temps. Je suis à mi-chemin de ces deux mondes. J’aime avoir la possibilité de les utiliser, même si je ne le fais peut-être pas de la meilleure des façons.
Thibault : Eh bien, voilà une belle note finale. Il est surement temps de retourner à nos profils Facebook… Un grand merci Bret, je te remercie pour tout ce temps.
BEE : Au plaisir Thibault. Reparlons-nous rapidement (…) A bientôt.
Thibault : À bientôt Bret !
<
**********
PARTIE 2 : L’ANALYSE STILL IN ROCK DU PODCAST
Par Thibault S.
I. L’EVOLUTION DE L’INDUSTRIE MUSICALE
Le rapport à l’élitisme en matière de musique
C’est à l’occasion de sa
conversation avec John Densmore (ancien batteur des Doors) que Bret formule pour la première fois l’un de ses leitmotivs : exprimer une opinion (qui plus est négative) est souvent considéré comme élitiste. Cette idée, à laquelle je ne peux qu’adhérer, résulte d’un changement de l’industrie musicale autant qu’elle l’accompagne. Il faut dire que la “société du like” et l’aplanissement du niveau des critiques tendent à compliquer le processus critique.
Cela nous ramène justement à l’importance de la critique. Bret y théorise sa “
Generation Wuss” lors de
son dialogue avec Ezra Koenig, leader de Vampire Weekend. Il y décrit ces artistes, nés avant un peu avant les années 2000′, qui ne supportent plus la critique négative. C’est cette même génération que dénonce Ian Svenonius dans le titre “
Reparations“, “people talk about reparations, yeah, they do”). Bret l’oppose à la Generation X (née dans les années 70′) qui, parce que plus cool et détachée, n’a que très peu contesté la pertinence des critiques.
Ezra Koenig s’inscrit en faux, défendant l’idée que toutes les générations ont du mal à accepter la critique. Les deux protagonistes tombent toutefois d’accord sur un autre point : il est plus facile de critiquer derrière un écran qu’en face à face. C’est aussi, en un sens, le sujet auquel
s’attaque Kurt Vile lorsqu’il dénonce les lecteurs de BrooklynVegan. Il y décrit ces “
pseudo hipster dudes” comme étant particulièrement acerbes. Bret soulève qu’Internet permet de faire surgir ces opinions, qui étaient là avant, mais simplement moins visibles.
Je ne peux m’empêcher de poser la question : et alors ? Pourquoi le fait de prendre sa plume serait-il moins légitime que celui de prendre la parole ? L’important ne devrait-il pas être, avant tout, la sincérité de la critique délivrée ? Certes, le problème de la critique sur Internet (et des commentaires sur les sites spécialisés) est de ne pas laisser la possibilité à l’artiste de répondre, mais cela ne décrédibilise pas les bonnes critiques qui peuvent être publiées. L’anonymat libère la critique plus qu’il déresponsabilise.
Mais revenons-en au phénomène d’élitisme. Il faut noter que ce dernier est également créé par une culture qui se constitue de plus en plus en “culture de niches”, où chacun se dit être spécialiste d’un sous-segment. Et cette culture de niche est le résultat de la société de la sur-information (ou société du “
endless dream of content“, comme il la décrit dans son entretien avec Marylin Manson). Si certains s’y perdent et finissent par baisser les bras (
i.e., les auditeurs radio), d’autres en profitent pour en faire leur miel, exploitant toute la matrice de la culture rock. Mais qu’y a-t’il de mal à ce que les niches se développent ? Que peut-on reprocher au fait que le rock’n’roll ne remplisse plus les stades comme le faisait Led Zeppelin ? N’oublions pas que ce n’était pas sa vocation.
Breat Easton Ellis met le doigt sur l’une des autres caractéristiques essentielles d’une telle société au cours
son entretien avec Bruce Wagner. L’inondation permanente d’informations tendrait à ce que certains jeunes artistes peinent à s’intéresser à ce qui a exister avant leur naissance.
On se rappelle alors de sa conversation avec Ariel Pink (l’une des plus riches de tous) qui fait état d’un avis plus tranché : peut-être que les sixties ne sont pas fait pour durer, peut être qu’il faudra/faudrait oublier les Beatles, les Stones, les Kinks. Peut être faudrait-il laisser les jeunes artistes créer de la mauvaise musique, sans que ces figures paternelles planent constamment en fond, le but étant que les artistes de demain aient la possibilité de se rendre compte par eux même de la médiocrité ou du génie de certaines créations. La société digitale de la sur-information a alors l’avantage de maintenir cette grisaille sur le génie du passé. On notera toutefois que ce raisonnement suppose d’admettre l’objectivité en matière d’art. Sans ça, comment concevoir que les artistes d’aujourd’hui puissent se rendre compte de la médiocrité de certaines compositions sans disposer d’éléments comparatifs ? Si je défends l’existence d’une telle objectivité, celle qu’Oscar Wilde décrivait si bien, je ne peux m’empêcher de penser que l’histoire ne s’arrête pas là.
En réalité, comment accepter l’idée que les véritables génies du passé soient oubliés au profit du mainstream toujours plus actuel. Peut-on souhaiter une société où le mot Beatles ne serait qu’une mauvaise orthographe du mot “scarabée” (“beetle“) en anglais ? Peut-on souhaiter une scène musicale qui ne saurait plus ce qu’est le blues ? Peut être ces exemples sont-ils extrêmes, mais on trouve là la limite du raisonnement tenu par Ariel Pink. C’est pour cette raison que Still in Rock continuera d’être, dans une volonté (certes pompeuse) de dénicher ce qui doit l’être, sorte d’anti-envahissement de la scène. Les publications de qualité (dont j’exclue pour le coup Still in Rock) doivent persister dans le but de conjurer le trop-plein de contenus, parce que les légendes sont nécessaires aux artistes de demain, objectivité de l’art ou pas. Gageons que les meilleurs sauront se détacher des pères fondateurs, tandis que les moins bons auront au moins la bonne idée de les copier.
La distinction empire / post-Empire.
La
conversation avec Marilyn Manson est intéressante à plusieurs égards. Si elle est majoritairement axée sur l’industrie du cinéma, on y trouve quelques réflexions pertinentes en matière de racisme, de la place du rap dans la culture pop, et, surtout, de l’anti-système. Manson explique qu’il est désormais coincé dans la culture pop qu’il critiquait à ses débuts, comprenez là, coincé dans l’Empire.
Cette culture Empire, c’est la culture du
blockbuster, la culture du rock de stade, la culture de la diffusion d’une œuvre à tout prix. Bret consacre une large partie de son analyse sur la distinction Empire / post-Empire à l’occasion de
son entretien avec Gerard Way. Ce dernier défend une volonté d’intégrer le plus de théâtralité possible dans sa musique. C’est le même combat que portait David Bowie. Bret ne s’oppose pas à une telle démarche. Pourtant, comment (et pourquoi) admettre qu’il soit normal qu’un artiste fabrique un faux mystère autour de lui, se fabrique un personnage, une identité ? Une fois encore, Lester Bangs dénonçait les artistes “vides” de la Blank Generation que les commerciaux pouvaient “remplir” à leur guise. Un artiste qui admet rechercher une théâtralité confesse ainsi cacher sa véritable identité. Dans quelle mesure une identité pré-fabriquée peut-elle intéresser ? Je pense la réponse être simple : aucune. Le contraire serait donner raison à cette industrie Empire où la commercialité, l’énorme et le sensationnel doivent triompher à tout prix (
au prix même de l’humain).
Le débat Empire / post-Empire resurgit à l’occasion de sa discussion avec John Densmore. La question de la commercialité en matière de musique est centrale. John Densmore explique que Jim Morrison était opposé à ce que les titres des Doors soient utilisés à des fins commerciales. Le reste du groupe était plus mitigé. Bret, pour sa part, semble s’opposer au point de vue de Jim Morrison, dressant une analogie avec sa situation. Il explique en effet que l’existence de son podcast est soutenue par la publicité qu’il y fait. Seulement, Bret se méprend à mon sens sur la distinction qui existe entre un podcast et un groupe de rock’n’roll. Le premier peut, en effet, être le support de sujets sérieux, il peut donc intégrer le système. Le second ne doit pas l’être, un rock’n’roll conforme est un rock’n’roll mort. L’opinion ici défendue par Bret est surprenante tend il semble par ailleurs défendre l’idée que le rock’n’roll ne doit pas être un art sérieux (au contraire de John Densmore). En somme, l’opinion de Bret en terme Empire / post-Empire est complexe et multi-niveaux. Il rejette la société Empire en ce qu’il appelle de ses vœux des groupes anti-système, et pourtant, admet sa commercialité. Vous aurez bien noté nos différences sur ce point.
Sur le cynisme en matière d’art
L’un des tout meilleurs podcasts de Bret est à mon sens
celui réalisé avec Stephen Malkmus (
ex-leader de Pavement). Ce podcast indique, pour commencer, que Bret a le très bon gout d’inviter le plus grand. Si Bret Beaston Ellis n’hésite pas à lui témoigner son admiration,
notons que Craig Finn se prête également au jeu lorsqu’il fait remarquer à quel point Pavement a modifié sa perception du concept de “groupe”, faisant de ce dernier une sorte de mouvement
post-collegial be yourself où il était possible, pour la première fois, de parler de sport à un concert de punk.
Bret profite de sa conversation avec Stephen Malkmus pour exprimer son attachement à certains groupes de Classic Rock (comme les Eagles et Led Zeppelin), ce avec quoi je me désolidarise (
lire l’article sur Lester Bangs). Pourtant, Bret y dénonce American Idol et toutes ces émissions qui cherchent faire triompher la technique au détriment de l’âme d’un artiste. Le discours semble contradictoire. Et puis, Bret décrit Pavement comme le premier groupe à avoir importé une nouvelle sensibilité dans la musique, lo-fi, cool, cynique. Pavement était le premier groupe à ne pas avoir d’image, au contraire des Replacements, dit-il. Bret semble adouber cette démarche, ce qu’il se refuse pourtant à faire avec Gerard Way. Il y voit le symbole de la génération X, un groupe qui ne se prenait pas au sérieux, un groupe qui évitait le trop facile du sensationnalisme.
Lorsque Pavement compose un hit (“
Cut Your Hair”), il le fait par pur cynisme. “Vous vouliez un hit ? Le voilà, mais sachez que ce n’est pas nous”. Cette culture anti-populaire, cette culture qui les aura poussés à rester avec Matador et à rejeter les majors, c’est probablement Pavement qui l’incarne le mieux du monde. L’approbation de Bret indique beaucoup sur son attitude vis-à-vis de la scène. Malkmus et Bret s’accordent sur le fait que les eighties étaient une mauvaise décennie, parce que, en somme, Malkmus dénonce ces artistes qui étaient façonnés par leurs managers. On en revient à la Blank Generation.
On retrouve une réflexion similaire dans
sa discussion avec Craig Finn lorsqu’il explique aimer la bêtise (“
dumbness“) dans le rock’n’roll. C’est aussi ce que l’on en déduit de cette même conversation lorsque Bret déplore le fait de ne plus trouver de groupes anti-système. Et puis, de nombreuses fois au cours de sa deuxième saison, Bret constate à quel point l’industrie de l’entertainment a cessé de financer les petits et moyens projets. Il se demande même si, finalement, réaliser des films et produire des albums ne devrait pas devenir un simple hobby (c’est d’ores et déjà le cas de petits labels indépendants qui font un boulot remarque,
i.e. Howlin Banana Records), comme pour se débarrasser de l’Empire.
Dans une longue tirade, Stephen Malkmus dénonce ces interviews où les journalistes considéraient Pavement comme “un simple produit”. Il finit par interpeler Bret quant à sa relation à la célébrité, ce à quoi il répond qu’il préfère toujours sourire et répondre gentiment aux journalistes, conscient d’être devenu “show business”. Alors oui, la relation entre Bret et le showbizz est complexe, parce que constante, mais en partie faussée parce que Bret en joue, cynique lui aussi, victime d’une sur-peopolisation qui l’aura mis sous le feu des projecteurs alors qu’il n’avait que 20 ans.
II. LE ROCK’N’ROLL COMME REFLETS
La culture “singles” comme reflet d’une société de l’instant
L’un des sujets les plus récurrents du podcast de Bret touche à la distinction entre
singles et full LP. Dans son
podcast avec Marilyn Manson, Bret souligne très justement que l’on vit dans une société où la culture est fragmentée. YouTube s’est imposé comme l’un des médias majeurs, principalement grâce à son format (très) court. La culture des
singles ne cesse de se développer. Apprendre à jouer de la musique est perçu comme un obstacle, celui du temps, celui qui empêche la célébrité, alors que le processus devrait être vécu comme une fin en soi.
L’
entretien avec Kurt Vile est celui qui aborde le plus franchement ce sujet (outre le fait que l’on y apprenne que Pavement est l’un des groupes préférés de K.V., ainsi que ce dernier déteste Muse). Bret déplore le fait que le single soit devenu le message tandis que l’album en son entier est devenu héroïque, là où, pourtant, le sens véritable se trouve dans l’expérience d’ensemble. L’intensité d’un bon album est grandissante, celle d’un single est linéaire. Il en rajoute à l’occasion de son entretien avec Ariel Pink, disant qu’il est probablement une faute majeure que de penser en terme de
singles.
Cette société du
single, ou société de l’instant, s’accompagne également du tout-digital. Les réseaux sociaux permettent la diffusion très rapide de ces musiques… trop rapides. Bret introduit alors l’idée d’une distinction entre le monde analogue et celui digital en terme de mysticité. Le premier, moins rapide que le second, tend à préserver la mysticité des artistes. C’est également
ce que défend John Densmore.
Après tout, l’art n’est-il pas qu’une affaire de contexte ? C’est ce
que pense James Grey. L’appréciation que l’on en fait dépend du moment où on le vit, ainsi que de son médium. On peut alors se poser la question des “mises en condition”, comme j’aime à les appeler. L’expérience est-elle la même lorsque je clique sur “play” que lorsque je dispose un vinyle sur une platine ? Certainement pas !
Et pourtant,
comme Nic Hessler me l’a confié, qui n’a jamais apprécié l’écoute d’un mp3 ? De plus, comment se plaindre de cette culture de l’abondance où il est peu ou prou possible d’accéder à l’écoute de n’importe quels groupes sur terre ? Dans le même temps, combien ceux sont qui profitent en plein des possibilités d’Internet, ceux qui ne se contentent pas d’être guidés par la culture radio ? On en revient à la problématique de la société de la sur-information. Le fait est que si le digital permet d’accéder à la musique plus facilement, l’importance des
lives se trouve grandissante (il n’y a qu’à voir le nombre de festivals qui se créent, ainsi que la taille de ces derniers qui n’a de cesse de croitre). Et la raison est simple, la musique est affaire d’analogie.
Visionner un clip sur YouTube ne remplacera jamais le fait de se rendre à un concert, ne serait-ce que pour aller voir un bluesman qui joue seul de sa guitare. Je ne crois pas que la digitalisation de la musique puisse beaucoup plus se développer. Ce que le réel peut pallier l’a probablement déjà été, comme filmer une session à l’autre bout du monde. Le reste appartient aux scènes, à l’odeur d’une foule, la sensation d’une salle plongée dans le noir, et, dans une autre mesure, au plaisir d’utiliser un objet (vinyle, K7) pour écouter sa musique. Le processus en devient alors unique et personnel. L’auditeur sort de l’expérience globale et répétable d’un clip sur YouTube.
Le rock’n’roll comme reflet des problématiques sociales
Comme le disait Lester Bangs, le rock’n’roll n’est jamais que le reflet de la société, à défaut d’être l’un de ses moteurs. Mais quel reflet ! La réflexion sur le féminisme trouve ainsi une parfaite illustration en matière de musique.
Son entretien avec Ariel Pink est l’occasion d’évoquer ce mouvement, dans la musique et ailleurs. Bret y défend une société post-féministe, comme il appelle souvent de ses vœux une société post-gay (entendez par là une société où l’homosexualité n’est plus le sujet central des œuvres, mais l’un des nombreux éléments qui les composent). Cette société post-féministe, explique-t-il, est la condition
sine qua non pour que les objectifs du féminisme soient atteints. Il est alors faux de dire que l’on ne soit pas encore entrer dans une société post-féministe parce que les objectifs du féminisme ne sont pas encore atteints. Cette réflexion pose la question de la sexualité dans la musique. Avec le mouvement Riot Grrrl né à Washington D.C. au début des années ‘90, toute une scène féministe punk se développe en réaction à celle beaucoup plus forte en testostérone, celle des Fugazi & co. C’était salvateur. Mais que penser des artistes d’aujourd’hui qui remettent constamment ce sujet sur la table ? Le sujet de la sexualité dans la musique ne doit-il pas être transcendé ? Peu de mannequins se reconvertissent en rock-star underground, preuve en est que la scène indépendante s’est extirpée des clichés prégnants de la société “magazines féminins”, non ?
Cette réflexion est poursuivie dans
son entretien avec Peaches. Bret complète ainsi sa théorie : les stars à la Miley & co utilisent le sexe pour vendre leurs chansons tandis que les hommes s’en dispensent. Peaches rétorque que les deux l’utilisent, mais différemment. Selon elle, les femmes incarnent le sexe tandis que les hommes en parlent. S’il me semble effectivement vrai que les hommes et femmes en parlent, force est de constater que beaucoup plus de femmes l’incarnent. De plus, les hommes se servent également de l’image sexuelle de la femme, voir 80% des clips sur YouTube, ce que, force est de constater, les femmes font moins. Il y aura donc toujours un problème d’image et d’identité sexuelle, mais seulement dans la musique mainstream, loin de nos scènes indépendantes qui me semblent moins en souffrir. Il est indéniable que le problème de l’utilisation de l’image de la femme comme moyen de vendre la musique est bien plus poussé chez les majors que les indépendants. Lorsque j’entends ainsi dire que la musique indépendante n’existe plus, je ne peux m’empêcher de soulever cette différence fondamentale avec la “scène télévisée”, appelons-là ainsi.
Le débat sur l’identité sexuelle est poursuivi
dans sa conversation avec Rose McGowan. Bret complète son point de vue en démontrant que les films et séries expliquent aux femmes que le regard des autres conditionne leur futur. À l’inverse, ils révèlent une différente image des hommes, où on leur apprend qu’ils sont maîtres de leur destin. Si tant est que cette affirmation soit avérée, c’est, à mon sens, la différence entre Kim Gordon (leader de Sonic Youth) et la (très) grande majorité des autres. Cet “autre” comprend Madonna qui, comme le dit Ariel Pink, “n’a jamais été libre”, preuve en est qu’elle n’a jamais été capable de véritablement se connecter avec son public, car trop professionnelle et trop ambitieuse.
QUELQUES MOTS CONCLUSIFS
Le podcast de Bret
ne fait pas l’unanimité. Certains en sont toutefois
tombés amoureux. Même si je note plusieurs points de désaccord avec ses opinions, je ne peux m’empêcher de penser qu’il constitue l’un des espaces de dialogues les plus intelligibles et intelligents en matière d’art. Toute personne qui a un intérêt quelconque pour la musique, le cinéma, la littérature, la peinture ou toute autre forme d’art devrait tenter l’expérience de ce podcast. On y réfléchit pour la première fois à des sujets qui le méritent. Comment ne pas y voir la marque d’un très grand ?






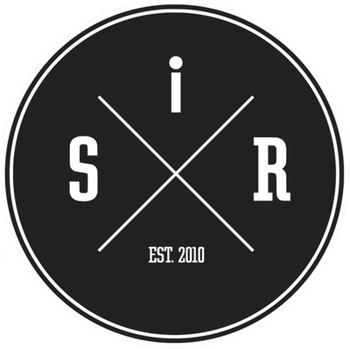







Post a comment